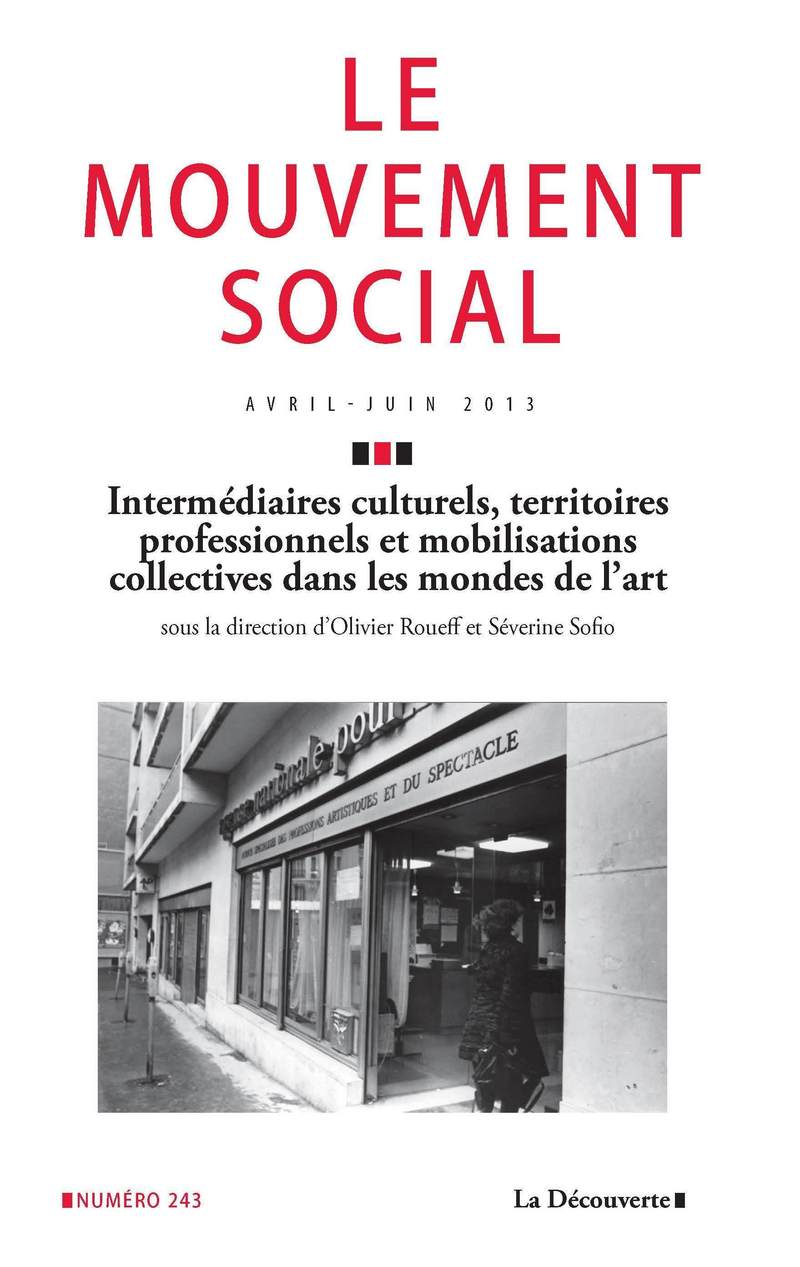On en parle… Recensions de l’ouvrage Les Galeries d’art contemporain à Paris. Une histoire culturelle du
marché de l’art, 1944-1970
Ce billet sera régulièrement
mis à jour.
- C. R., « Les galeries d’art contemporain à Paris », L’Agora des arts, mis en ligne en février 2013 : http://www.lagoradesarts.fr/Les-galeries-d-art-contemporain-a.html
- Jean-Christophe Castelain, « Naissance des galeristes », Le Journal des Arts, n°385, 15-28 février 2013, p. 18. Article disponible en ligne : http://www.lejournaldesarts.fr/jda/archives/docs_article/109149/naissance-des-galeristes.php
- Jacques Bouzerand, « Julie Verlaine :Tout pour la galerie… », monoeilsurlart, URL : http://jacquesbouzerand.blog.lemonde.fr/2013/03/21/julie-verlaine-tout-pour-la-galerie/ (mis en ligne le 21 mars 2013)
- Anne Gagnebien, « Julie Verlaine, Les galeries d'art contemporain à Paris de la Libération à la fin des années 1960. Une histoire culturelle du marché de l'art, 1944-1970 », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2013, mis en ligne le 04 juin 2013. URL : http://lectures.revues.org/11665
- Sophie Cras, « Notes de lecture. Julie Verlaine, Les galeries d'art contemporain à Paris de la Libération à la fin des années 1960. Une histoire culturelle du marché de l'art, 1944-1970 », Le Mouvement Social 2/2013 (n° 243), p. 117-141.URL : www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2013-2-page-117.htm.
- Jacques Leenhardt, « Julie Verlaine, Les Galeries d’art contemporain à Paris : une histoire culturelle du marché de l’art, 1944-1970 », Critique d'art, n°41, printemps-été 2013, p. 152. Critique d’art [En ligne], 41 | Printemps/Eté 2013, mis en ligne le 24 juin 2014, URL : http://critiquedart.revues.org/8346
- Guy Boyer, « Galeries d'après-guerre », Connaissance des arts, 19 juillet 2013. URL : http://www.connaissancedesarts.com/marche_art/actus/galeries-d-apres-guerre-102841.php
- Nathalie Heinich, "Julie Verlaine, Les Galeries d'art contemporain à Paris. Une histoire culturelle du marché de l'art, 1944-1970", Les Annales. Histoire, sciences sociales, 2013/3, p. 927-929. URL : www.cairn.info/revue-annales-2013-3-page-851.htm.
- Béatrice Joyeux-Prunel, "Julie Verlaine, Les Galeries d'art contemporain à Paris. Une histoire culturelle du marché de l'art, 1944-1970", Revue historique, 2015/2, n°674, p. 470-474. URL : www.cairn.info/revue-historique-2015-2-page-413.htm