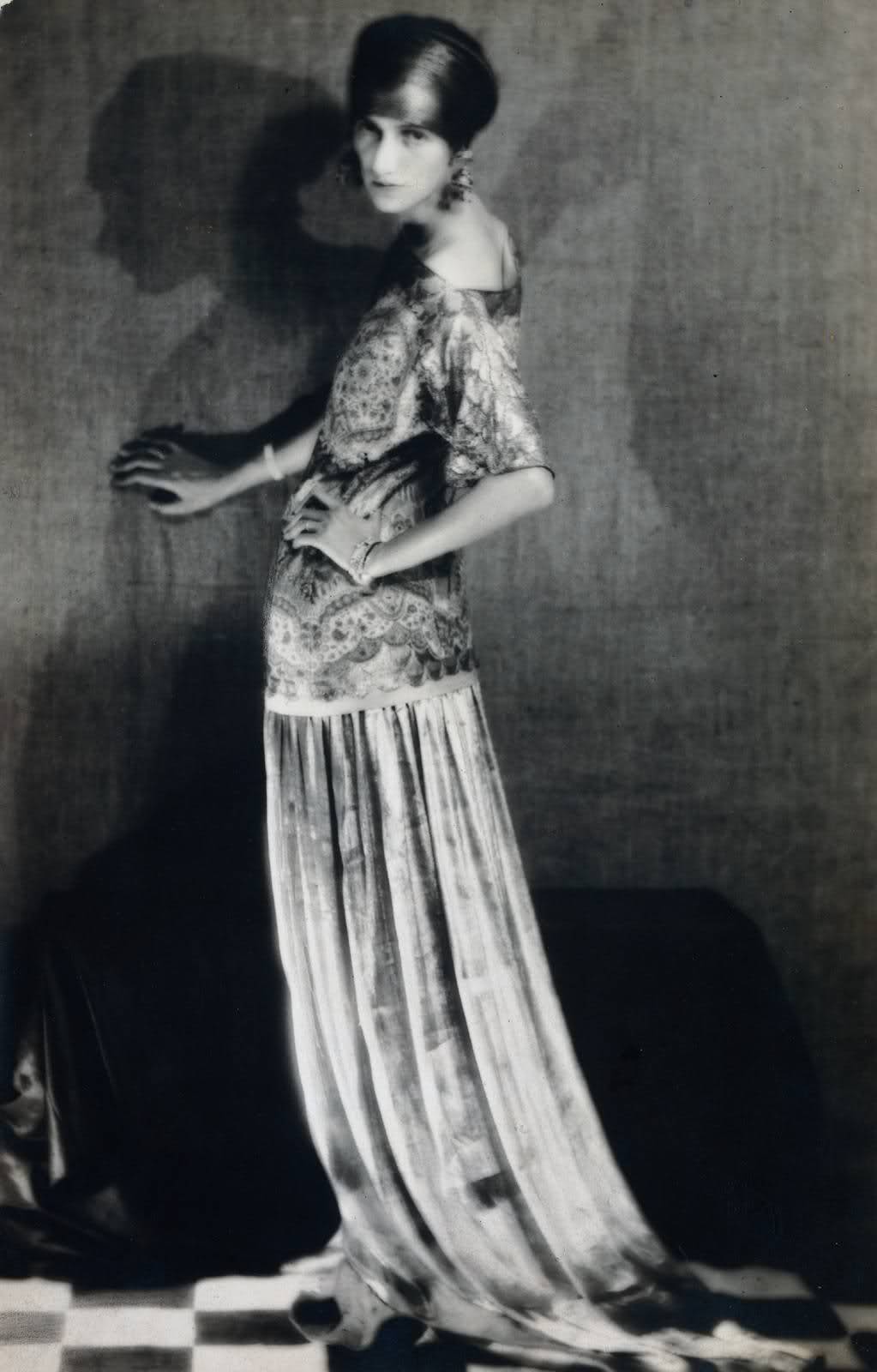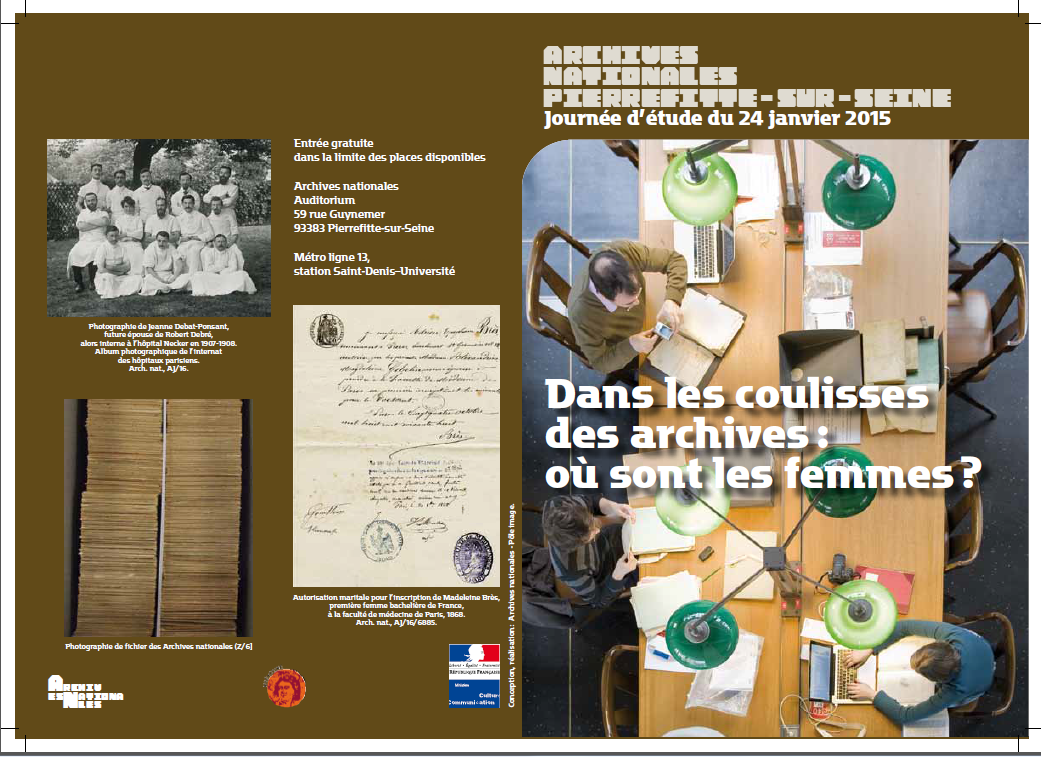lundi 30 novembre 2015
Intervention au séminaire "Histoire des médias, de l'image et de la communication", Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines
4 décembre 2015 :
Histoire culturelle, histoire de l’Art
Julie Verlaine (Univ. Paris 1 / Centre d’histoire sociale du XXe s.), Femmes collectionneuses et mécènes de 1880 à nos jours.
Clara Bouveresse (Uni. Paris 1 / HiCSA), L’agence Magnum Photos de 1947 à nos jours.
Lieu :
UVSQ (salle 524 ou 610)
Bâtiment Vauban
Boulevard Vauban
78280 Guyancourt
Programme du séminaire
Une vie une oeuvre : Peggy Guggenheim
En plus d'avoir été une collectionneuse particulièrement avisée, Peggy Guggenheim
aura donc été une mécène sur laquelle de nombreux artistes auront
compté pendant et après la guerre, y compris Jackson Pollock à ses
débuts.
Issue d’une très riche famille juive de New York, Peggy Guggenheim s’ennuie très tôt dans son enfance dorée. Elle perd son père volage dans le naufrage du Titanic et désormais, non seulement elle s’ennuie, mais en plus elle est malheureuse…De voyages en voyages elle finit par s’installer en France ou elle anime les folles soirées de Montparnasse en cherchant à s’encanailler au milieu des artistes. Elle y rencontre son mari Laurence Vail, ils vivent ensemble une riche vie de bohème entre alcool et avants gardes, ont deux enfants et finissent par divorcer.
Marcel Duchamp va l’initier à l’art moderne puis au surréalisme : elle a enfin trouvé comment dépenser son argent. Elle fréquente tous les artistes du moment et commence à les financer… Mais la guerre approche et avec cette menace nait son désir de collectionner les œuvres d’art comme elle collectionne les histoires d’amour…avec passion, enthousiasme, voire voracité. Elle va réunir « la » collection de référence en ce qui concerne le surréalisme.
Peggy Guggenheim est pleine de complexes et pourtant il est difficile d’exister aux côtés de cette papesse du surréalisme qui vivra une histoire d’amour avec Beckett et une autre avec Max Ernst…Elle a su développer son œil et sera une des premières à exposer Jackson Pollock. Elle finira sa vie dans son palais de Venise, entourée de sa collection devenue incontournable et de ses chiens. Elle est désormais la « dogaressa » dont les lunettes de soleil et les boucles d’oreille sont entrées dans la légende.
Avec
Laurence Tacù, directrice des éditions de l’Herne et auteure de Peggy Guggenheim (Flammarion)
Julie Verlaine, historienne à Paris 1 et auteure de Femmes collectionneuses et mécènes, de 1880 à nos jours (Hazan)
Fabrice Falhutez, historien de l’art à Paris Ouest Nanterre La Défense, spécialisé dans le surréalisme et son internationalisation.
Pour réécouter l'émission : http://www.franceculture.fr/emission-une-vie-une-oeuvre-peggy-guggenheim-la-folie-de-la-collection-1898-1979-2015-10-24
Issue d’une très riche famille juive de New York, Peggy Guggenheim s’ennuie très tôt dans son enfance dorée. Elle perd son père volage dans le naufrage du Titanic et désormais, non seulement elle s’ennuie, mais en plus elle est malheureuse…De voyages en voyages elle finit par s’installer en France ou elle anime les folles soirées de Montparnasse en cherchant à s’encanailler au milieu des artistes. Elle y rencontre son mari Laurence Vail, ils vivent ensemble une riche vie de bohème entre alcool et avants gardes, ont deux enfants et finissent par divorcer.
Marcel Duchamp va l’initier à l’art moderne puis au surréalisme : elle a enfin trouvé comment dépenser son argent. Elle fréquente tous les artistes du moment et commence à les financer… Mais la guerre approche et avec cette menace nait son désir de collectionner les œuvres d’art comme elle collectionne les histoires d’amour…avec passion, enthousiasme, voire voracité. Elle va réunir « la » collection de référence en ce qui concerne le surréalisme.
Peggy Guggenheim est pleine de complexes et pourtant il est difficile d’exister aux côtés de cette papesse du surréalisme qui vivra une histoire d’amour avec Beckett et une autre avec Max Ernst…Elle a su développer son œil et sera une des premières à exposer Jackson Pollock. Elle finira sa vie dans son palais de Venise, entourée de sa collection devenue incontournable et de ses chiens. Elle est désormais la « dogaressa » dont les lunettes de soleil et les boucles d’oreille sont entrées dans la légende.
Avec
Laurence Tacù, directrice des éditions de l’Herne et auteure de Peggy Guggenheim (Flammarion)
Julie Verlaine, historienne à Paris 1 et auteure de Femmes collectionneuses et mécènes, de 1880 à nos jours (Hazan)
Fabrice Falhutez, historien de l’art à Paris Ouest Nanterre La Défense, spécialisé dans le surréalisme et son internationalisation.
Pour réécouter l'émission : http://www.franceculture.fr/emission-une-vie-une-oeuvre-peggy-guggenheim-la-folie-de-la-collection-1898-1979-2015-10-24
mardi 24 mars 2015
Catalogue de l'exposition Pierre Boulez, 2015, Philharmonie de Paris
"Avignon, 1947", notice d’œuvre parue dans Sarah Barbedette (dir.), Pierre Boulez, Actes Sud / Cité de la musique, 2015.
Lien vers la page de l'éditeur
Lien vers le site de l'exposition
Lien vers la page de l'éditeur
Lien vers le site de l'exposition
lundi 9 mars 2015
Comment Paris a perdu l'idée d'art moderne : les échanges artistiques internationaux depuis 1945
Intervention au séminaire de Christpohe CHARLE, La fabrique des cultures en Europe, XIXe XXe siècles.
 L’histoire des cultures en Europe vise à s’interroger sur l’existence ou
non de formes culturelles véritablement transnationales, sinon
européennes. Cultures au pluriel car selon les types d’activités (arts,
littérature, arts décoratifs, arts populaires ou « moyens ») le régime
des circulations et des interférences ne revêt pas du tout les mêmes
formes. De la même manière, les cultures ont des rythmes d’évolution et
de transformation multiples selon les époques mais aussi leurs lieux de
lancement et de diffusion. Cette année, on mettra l’accent sur la
fabrique des cultures : comment les auteurs, les œuvres, les
institutions inventent des dispositifs nouveaux et spécifiques qui
contribuent à inventer de nouvelles conceptions ou formes durables
appelées à se diffuser hors de leur cadre local ou national initial. On
essaiera aussi de couvrir l’Europe dans sa définition la plus large, la
seule valide pour l’époque considérée qu’on a définie dans un ouvrage à
paraître prochainement comme celle de la « dérégulation culturelle ».
L’histoire des cultures en Europe vise à s’interroger sur l’existence ou
non de formes culturelles véritablement transnationales, sinon
européennes. Cultures au pluriel car selon les types d’activités (arts,
littérature, arts décoratifs, arts populaires ou « moyens ») le régime
des circulations et des interférences ne revêt pas du tout les mêmes
formes. De la même manière, les cultures ont des rythmes d’évolution et
de transformation multiples selon les époques mais aussi leurs lieux de
lancement et de diffusion. Cette année, on mettra l’accent sur la
fabrique des cultures : comment les auteurs, les œuvres, les
institutions inventent des dispositifs nouveaux et spécifiques qui
contribuent à inventer de nouvelles conceptions ou formes durables
appelées à se diffuser hors de leur cadre local ou national initial. On
essaiera aussi de couvrir l’Europe dans sa définition la plus large, la
seule valide pour l’époque considérée qu’on a définie dans un ouvrage à
paraître prochainement comme celle de la « dérégulation culturelle ».
Programme du séminaire en 2014-2015
 L’histoire des cultures en Europe vise à s’interroger sur l’existence ou
non de formes culturelles véritablement transnationales, sinon
européennes. Cultures au pluriel car selon les types d’activités (arts,
littérature, arts décoratifs, arts populaires ou « moyens ») le régime
des circulations et des interférences ne revêt pas du tout les mêmes
formes. De la même manière, les cultures ont des rythmes d’évolution et
de transformation multiples selon les époques mais aussi leurs lieux de
lancement et de diffusion. Cette année, on mettra l’accent sur la
fabrique des cultures : comment les auteurs, les œuvres, les
institutions inventent des dispositifs nouveaux et spécifiques qui
contribuent à inventer de nouvelles conceptions ou formes durables
appelées à se diffuser hors de leur cadre local ou national initial. On
essaiera aussi de couvrir l’Europe dans sa définition la plus large, la
seule valide pour l’époque considérée qu’on a définie dans un ouvrage à
paraître prochainement comme celle de la « dérégulation culturelle ».
L’histoire des cultures en Europe vise à s’interroger sur l’existence ou
non de formes culturelles véritablement transnationales, sinon
européennes. Cultures au pluriel car selon les types d’activités (arts,
littérature, arts décoratifs, arts populaires ou « moyens ») le régime
des circulations et des interférences ne revêt pas du tout les mêmes
formes. De la même manière, les cultures ont des rythmes d’évolution et
de transformation multiples selon les époques mais aussi leurs lieux de
lancement et de diffusion. Cette année, on mettra l’accent sur la
fabrique des cultures : comment les auteurs, les œuvres, les
institutions inventent des dispositifs nouveaux et spécifiques qui
contribuent à inventer de nouvelles conceptions ou formes durables
appelées à se diffuser hors de leur cadre local ou national initial. On
essaiera aussi de couvrir l’Europe dans sa définition la plus large, la
seule valide pour l’époque considérée qu’on a définie dans un ouvrage à
paraître prochainement comme celle de la « dérégulation culturelle ».Programme du séminaire en 2014-2015
lundi 2 mars 2015
Les galeries d'art (tout) contre le musée, 1945-1970
Intervention au séminaire de Master de Marie Gispert, Histoire de l'art, Université Paris 1 PAnthéon-Sorbonne
Vendredi 6 mars, 9h-11h, salle Demargne
Résumé : Cette intervention portera sur les relations ambivalentes qu'entretiennent les galeries d'art avec le musée comme institution, durant les 25 ans qui suivent la Seconde Guerre mondiale. L'hostilité déclarée n'exclut pas une adhésion aux critères de consécration...
Vendredi 6 mars, 9h-11h, salle Demargne
Résumé : Cette intervention portera sur les relations ambivalentes qu'entretiennent les galeries d'art avec le musée comme institution, durant les 25 ans qui suivent la Seconde Guerre mondiale. L'hostilité déclarée n'exclut pas une adhésion aux critères de consécration...
jeudi 19 février 2015
Femmes dans les expositions internationales 1878-1937 - vidéos du colloque
Les vidéos de la totalité du colloque "femmes dans les expositions
internationales 1878-1937" (présentation , communications, discussions,
conclusions) ainsi que le programme sont maintenant disponibles en
ligne; les vidéos sont disponibles sur le site du LARCA, Paris Diderot
1. sur la page d'accueil du LARCA
http://www.univ-paris-diderot.
2. et sous l'onglet recherche, LARCA
http://www.univ-paris-diderot.
3. ainsi que sur le site de plurigenre/ IHP/ Paris Diderot.: http://plurigenre.hypotheses.
Ce colloque s'est tenu à Institut d’études avancées de Paris, 17 quai d’Anjou, 75004 , le 23- 24 octobre 2014, organisé par rebecca.rogers@parisdescartes.
1. sur la page d'accueil du LARCA
http://www.univ-paris-diderot.
2. et sous l'onglet recherche, LARCA
http://www.univ-paris-diderot.
3. ainsi que sur le site de plurigenre/ IHP/ Paris Diderot.: http://plurigenre.hypotheses.
Ce colloque s'est tenu à Institut d’études avancées de Paris, 17 quai d’Anjou, 75004 , le 23- 24 octobre 2014, organisé par rebecca.rogers@parisdescartes.
Ce
colloque, réalisé dans le cadre de l’action structurante « PluriGenre
» de l’Institut des Humanités de Paris (université Paris Diderot), a
reçu le soutien des organismes suivants : L’Institut des Humanités de
Paris, l’Institut des études avancées de Paris, la Ville de Paris,
l’Institut Émilie du Châtelet, l’université Paris Descartes, le MAGE et
les laboratoires de recherche LARCA (université Paris Diderot),
Cerlis (université Paris Descartes), Présage (Sciences Po).
dimanche 25 janvier 2015
Marais en héritage / Marais renouvelé (atelier recherche Master / Musée Carnavalet)
Master Histoire des sociétés occidentales contemporaines, Centre
d’histoire sociale du vingtième siècle, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Master Urbanisme-Aménagement, Institut d'urbanisme de Paris, Université
de Paris Est-Créteil, M2 Spécialité « Espaces urbains et démarches de
projet », Atelier Recherche
Présentation des travaux
Marais en
héritage / Marais renouvelé
le mercredi 28 janvier 2015, de
9h à 14h
Musée Carnavalet
Accès par le 29 rue de Sévigné, métro Saint-Paul-Le Marais, Salon
Bouvier
(NB : carte d’identité demandée à l’entrée)
À la
demande du musée Carnavalet et dans l’objectif de réaliser une exposition sur
la mémoire des lieux et la transformation du quartier depuis sa sauvegarde et
mise en valeur, les étudiants ont réalisé des enquêtes sur un certain nombre
d’immeubles et de lieux. Les étudiants de Paris 1 présenteront les résultats de
leur recherche historique. Les étudiantes de Paris Est en urbanisme
soutiendront un travail d’enquête et de restitution de lieux du quartier. Le
Musée pourra utiliser, dans le cadre de l’exposition, les matériaux collectés
par les étudiants.
9h : Accueil et présentation :
Valérie
Guillaume (directrice du Musée Carnavalet) et Noémie Giard (responsable de
l’action culturelle, Musée Carnavalet)
Julie
Verlaine et Charlotte Vorms (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Nathan
Belval et Laurent Coudroy de Lille (Institut d’Urbanisme de Paris).
9h30-11h30 : Première
session :
Marie
Chamard, Elise Druart : Rue du Figuier – place Roger Priou-Valjean
Maeva
Baron, Marine Costille, Tiphaine Joyeux : Passage Charlemagne (119 rue
Saint-Antoine, 16 rue Charlemagne)
Jeanne
Beaucé, Gautier Sayetta-Audra : École 40 rue des Archives
Laurène
Prata, Pierre-Marie Vautier : 14-16 rue des Rosiers
Jeanne
Dufranc, Diane Claude (Institut d’urbanisme de Paris-UPEC) : Ambiances et
urbanisme dans le Marais
Pause
11h45-13h : Seconde session :
Carla
Brizzi, Hélène Duret : 66 rue Turenne
Clémence
Da Costa, Pauline Hugot : 78 rue du Temple
Nathan
Gallo, Romain Métairie : Marché des Enfants rouges
13h-14h : cocktail déjeunatoire
Le jury pour l’Institut d’Urbanisme de Paris sera
composé de : Institut d’Urbanisme de Paris et
Lab’urba : Nathan Belval, moniteur, Laurent Coudroy de Lille, Maître de
conférences UPEC-IUP, Morgane Delarc, Doctorante ; Université de Paris
1 : Julie Verlaine et Charlotte Vorms, maîtres de conférences ; Musée
Carnavalet : Valérie Guillaume, directrice, Noémie Giard, responsable du
service d’action culturelle. Invité : Juca Villaschi professeur au
Departamento de Turismo-Escola de Direito, Turismo e Museologia, Universidade
Federal de Ouro Preto (Brésil).
Dans les coulisses des archives : où sont les femmes ?
Journée d'étude de l'Association Mnémosyne, aux Archives nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine), le 24 janvier 2015
Les débats ont été filmés et les vidéos seront prochainement disponibles sur le site de Mnémosyne : http://mnemosyne.asso.fr
Les débats ont été filmés et les vidéos seront prochainement disponibles sur le site de Mnémosyne : http://mnemosyne.asso.fr
vendredi 16 janvier 2015
Le Musée face au veuvage
Julie Verlaine, « Le musée
face au veuvage : reconnaissance et postérité des artistes abstraits après 1945
», intervention à la journée d’études Veuves, veufs et veuvages en Europe du
XIXe siècle au XXIe siècle, Bordeaux, Université Bordeaux 3, 5 décembre 2014.
Programme complet : http://www.sites.univ-rennes2.fr/cerhio/IMG/pdf/programmecahdversionfinale.pdf
83, Quai d’Orsay. Vitrine ou écrin de la collection Delubac ?

« 83,
Quai d’Orsay. Vitrine ou écrin de la collection Delubac ? » article dans Jacqueline Delubac. Le choix de la
modernité, Rodin, Lam, Picasso, Bacon, catalogue d’exposition, Lyon, Actes
Sud / Musée des Beaux-arts de Lyon, 2014, p. 129-148.
Premières lignes
« Voilà ce que j'ai choisi, toujours seule,
finalement ! » C’est avec ces mots que Jacqueline Delubac, à la fin de sa
vie, accueille les curieux, journalistes, amateurs d’art et apprentis
collectionneurs, dans son splendide appartement parisien du 83, quai d’Orsay,
dans le septième arrondissement. Là se donne à voir une collection d’art de
taille modeste, mais de grande qualité, fortement déterminée par les goûts, les
souvenirs et la personnalité de sa propriétaire. Loin des collections
encyclopédiques, qui cherchent à représenter au mieux une période ou un motif
de l’histoire de l’art, loin également des collections narcissiques, composées
en majeure partie de portraits et d’objets liés à l’existence de la
collectionneuse, la collection assemblée par Jacqueline Delubac est un moyen
d’affirmer sa passion pour l’art, d’exprimer sa conception du beau et trouver un
épanouissement personnel distinct mais complémentaire de celui que lui a apporté
sa carrière de vedette. Le temps apaisé de la collection suit celui, bien plus
frénétique, des performances théâtrales et cinématographiques. Et c’est encore
plus tardivement, après plus d’un quart de siècle passé à collectionner en
toute discrétion, que Jacqueline Delubac ouvre les portes de son appartement. La
collectionneuse est désormais assez sûre de son goût pour y autoriser les
reportages photographiques ; ces images d’époque ont aujourd’hui valeur de
sources iconographiques exceptionnelles témoignant de la présentation des
œuvres in situ.
.
Inscription à :
Articles (Atom)